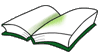A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur


 Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesLa guerre civile en Algérie 1990-1998 / Luis Martinez
Titre : La guerre civile en Algérie 1990-1998 Type de document : texte imprimé Auteurs : Luis Martinez Editeur : Paris : Karthala Année de publication : 1998 Collection : Recherches internationales Importance : 429 p. Format : 21,5 cm La guerre civile en Algérie 1990-1998 [texte imprimé] / Luis Martinez . - Paris : Karthala, 1998 . - 429 p. ; 21,5 cm. - (Recherches internationales) .Exemplaires
Code-barres Support Section Localisation Statut Disponibilité 1225 Livre International Mille Bâbords Absent Exclu du prêt Société et luttes anticoloniales à Madagascar (1896 à 1946) / Solofo RANDRIANJA
Titre : Société et luttes anticoloniales à Madagascar (1896 à 1946) Type de document : texte imprimé Auteurs : Solofo RANDRIANJA Editeur : Paris : Karthala Année de publication : 2001 Importance : 488 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84586-136-7 Langues : Français Résumé : Les luttes anticoloniales sont souvent perçues comme une opposition manichéenne entre le colonisateur racialement caractérisé et les colonisés inspirés par le colonialisme. L'exemple de Madagascar montre qu'entre la conquête et la veille de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs sensibilités anticolonialistes coexistent dans des rapports complémentaires, concurrentiels mais` aussi d'opposition. L'expression "mouvement d'émancipation", utilisée par les militants anticolonialistes de l'époque, convient peut-être la mieux pour qualifier cet assemblage que le Parti communiste de la région de Madagascar a tenté de regrouper, sans succès, à partir de 1936, le temps de "l'embellie" du Front populaire. Société et luttes anticoloniales à Madagascar (1896 à 1946) [texte imprimé] / Solofo RANDRIANJA . - Paris : Karthala, 2001 . - 488 p.
ISBN : 978-2-84586-136-7
Langues : Français
Résumé : Les luttes anticoloniales sont souvent perçues comme une opposition manichéenne entre le colonisateur racialement caractérisé et les colonisés inspirés par le colonialisme. L'exemple de Madagascar montre qu'entre la conquête et la veille de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs sensibilités anticolonialistes coexistent dans des rapports complémentaires, concurrentiels mais` aussi d'opposition. L'expression "mouvement d'émancipation", utilisée par les militants anticolonialistes de l'époque, convient peut-être la mieux pour qualifier cet assemblage que le Parti communiste de la région de Madagascar a tenté de regrouper, sans succès, à partir de 1936, le temps de "l'embellie" du Front populaire. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Support Section Localisation Statut Disponibilité 4018 Livre Anticolonialisme Mille Bâbords Document en bon état Disponible Enfermement, prison et châtiments en Afrique / Florence BERNAULT
Titre : Enfermement, prison et châtiments en Afrique : Du 19e siècle à nos jours Type de document : texte imprimé Auteurs : Florence BERNAULT, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Karthala Année de publication : 1999 Importance : 512 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86537-946-0 Langues : Français Résumé : A la fin du XIXe siècle, sauf à l'intérieur de quelques garnisons et forts de traite européens de la côte, les prisons étaient inconnues en Afrique. Aujourd'hui, les États africains utilisent massivement le système pénitentiaire légué par les colonisateurs. Comme le rappellent chaque jour les prisons surpeuplées du Rwanda, la nuit carcérale étend désormais son ombre sur l'ensemble des sociétés au sud du Sahara. Dès les premières années de la conquête coloniale, la prison joua un rôle central dans le contrôle de la population. Des bâtiments temporaires aidèrent à contraindre et à soumettre les Africains au travail forcé et à l'impôt obligatoire, remplacés bientôt par un maillage serré de prisons permanentes, partie intégrante du décor colonial et de ses techniques répressives. Aujourd'hui, ce réseau architectural n'a été ni détruit ni remplacé, et fournit la majeure partie des bâtisses utilisées par le régime pénal des États contemporains. Mais la prison fait partie d'un ensemble plus vaste. Les gouvernements coloniaux dotèrent leurs territoires d'institutions destinées à connaître, comprendre et surtout quadriller les espaces et les hommes qui persistaient à leur échapper. Ces outils intellectuels et matériels - cartes ethniques, routes, villages regroupés, asiles, camps de travail - enfermèrent peu à peu l'Afrique dans une nouvelle forme d'espace politique, dont les paysages actuels sont les héritiers directs. Ce basculement séculaire d'une Afrique ouverte à une Afrique fermée contient de précieuses leçons sur l'efficacité des modèles de gouvernement occidentaux à envahir d'autres aires culturelles, sur la capacité des hommes ordinaires à refuser ou à manipuler les systèmes imposés de l'extérieur, ainsi que sur le destin de l'autorité en Afrique, et de ses États. Cet ouvrage présente pour la première fois l'histoire sociale, culturelle et politique des arsenaux répressifs apparus en Afrique, depuis la capture des esclaves au XIXe siècle jusqu'aux prisons du génocide rwandais, en passant par les asiles d'aliénés coloniaux, les camps de réfugiés, et les réponses des prisonniers à leurs bourreaux. Enfermement, prison et châtiments en Afrique : Du 19e siècle à nos jours [texte imprimé] / Florence BERNAULT, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Karthala, 1999 . - 512 p.
ISBN : 978-2-86537-946-0
Langues : Français
Résumé : A la fin du XIXe siècle, sauf à l'intérieur de quelques garnisons et forts de traite européens de la côte, les prisons étaient inconnues en Afrique. Aujourd'hui, les États africains utilisent massivement le système pénitentiaire légué par les colonisateurs. Comme le rappellent chaque jour les prisons surpeuplées du Rwanda, la nuit carcérale étend désormais son ombre sur l'ensemble des sociétés au sud du Sahara. Dès les premières années de la conquête coloniale, la prison joua un rôle central dans le contrôle de la population. Des bâtiments temporaires aidèrent à contraindre et à soumettre les Africains au travail forcé et à l'impôt obligatoire, remplacés bientôt par un maillage serré de prisons permanentes, partie intégrante du décor colonial et de ses techniques répressives. Aujourd'hui, ce réseau architectural n'a été ni détruit ni remplacé, et fournit la majeure partie des bâtisses utilisées par le régime pénal des États contemporains. Mais la prison fait partie d'un ensemble plus vaste. Les gouvernements coloniaux dotèrent leurs territoires d'institutions destinées à connaître, comprendre et surtout quadriller les espaces et les hommes qui persistaient à leur échapper. Ces outils intellectuels et matériels - cartes ethniques, routes, villages regroupés, asiles, camps de travail - enfermèrent peu à peu l'Afrique dans une nouvelle forme d'espace politique, dont les paysages actuels sont les héritiers directs. Ce basculement séculaire d'une Afrique ouverte à une Afrique fermée contient de précieuses leçons sur l'efficacité des modèles de gouvernement occidentaux à envahir d'autres aires culturelles, sur la capacité des hommes ordinaires à refuser ou à manipuler les systèmes imposés de l'extérieur, ainsi que sur le destin de l'autorité en Afrique, et de ses États. Cet ouvrage présente pour la première fois l'histoire sociale, culturelle et politique des arsenaux répressifs apparus en Afrique, depuis la capture des esclaves au XIXe siècle jusqu'aux prisons du génocide rwandais, en passant par les asiles d'aliénés coloniaux, les camps de réfugiés, et les réponses des prisonniers à leurs bourreaux. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Support Section Localisation Statut Disponibilité 4020 Livre Anticolonialisme Mille Bâbords Document en bon état Disponible L'insurrection des menalamba / Stephen ELLIS
Titre : L'insurrection des menalamba : Une revolte à Madagascar (1895-1898) Type de document : texte imprimé Auteurs : Stephen ELLIS, Auteur ; Faranirina V. RANDRIAMBELOMA, Traducteur Editeur : Paris : Karthala Année de publication : 1998 Importance : 282 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86537-796-1 Langues : Français Langues originales : Anglais Résumé : Madagascar, 1895. Une armée expéditionnaire fait son entrée à Tananarive, capitale du royaume merina sur les hauts plateaux de Madagascar, la Grande île de l'océan Indien. En moins de deux mois, des troubles s'annoncent avec une attaque contre des fonctionnaires malgaches à l'Ouest de la capitale de Madagascar. Parmi les premières victimes figure une famille missionnaire anglaise. C'est le début de l'insurrection des menalamba. L'année suivante, une véritable guerre civile se déclenche au centre de Madagascar et s'étend à d'autres parties de l'île. On parle d'une direction centralisée, soutenue par la reine Ranavalona III et les hauts fonctionnaires malgaches sous le protectorat. La présence française est menacée. Le gouvernement français annonce l'annexion de la Grande île. Madagascar ne recouvre son indépendance qu'en 1960. La révolte des menalamba a profondément marqué l'histoire de Madagascar. Parmi les Européens de l'époque, il y a ceux, comme le général Gallieni, le premier gouverneur-général de la colonie de Madagascar, qui voient dans la révolte un mouvement organisé par l'aristocratie merina opposée au progrès politique et social proposé par la France. D'autres, missionnaires catholiques ou protestants, y voient une réaction religieuse dans une société divisée par des conversions aux traditions chrétiennes rivales. Plus tard, certains nationalistes malgaches verront dans les menalamba des nationalistes de la première heure. Se fondant sur des archives et des ouvrages écrits en français, en malgache, en anglais et en norvégien, ce livre nous offre une reconstruction narrative de la révolte des menalamba, de 1895 à 1898. Il nous montre les racines de ce mouvement dans l'histoire des sociétés malgaches au XIXe siècle. L'insurrection des menalamba : Une revolte à Madagascar (1895-1898) [texte imprimé] / Stephen ELLIS, Auteur ; Faranirina V. RANDRIAMBELOMA, Traducteur . - Paris : Karthala, 1998 . - 282 p.
ISBN : 978-2-86537-796-1
Langues : Français Langues originales : Anglais
Résumé : Madagascar, 1895. Une armée expéditionnaire fait son entrée à Tananarive, capitale du royaume merina sur les hauts plateaux de Madagascar, la Grande île de l'océan Indien. En moins de deux mois, des troubles s'annoncent avec une attaque contre des fonctionnaires malgaches à l'Ouest de la capitale de Madagascar. Parmi les premières victimes figure une famille missionnaire anglaise. C'est le début de l'insurrection des menalamba. L'année suivante, une véritable guerre civile se déclenche au centre de Madagascar et s'étend à d'autres parties de l'île. On parle d'une direction centralisée, soutenue par la reine Ranavalona III et les hauts fonctionnaires malgaches sous le protectorat. La présence française est menacée. Le gouvernement français annonce l'annexion de la Grande île. Madagascar ne recouvre son indépendance qu'en 1960. La révolte des menalamba a profondément marqué l'histoire de Madagascar. Parmi les Européens de l'époque, il y a ceux, comme le général Gallieni, le premier gouverneur-général de la colonie de Madagascar, qui voient dans la révolte un mouvement organisé par l'aristocratie merina opposée au progrès politique et social proposé par la France. D'autres, missionnaires catholiques ou protestants, y voient une réaction religieuse dans une société divisée par des conversions aux traditions chrétiennes rivales. Plus tard, certains nationalistes malgaches verront dans les menalamba des nationalistes de la première heure. Se fondant sur des archives et des ouvrages écrits en français, en malgache, en anglais et en norvégien, ce livre nous offre une reconstruction narrative de la révolte des menalamba, de 1895 à 1898. Il nous montre les racines de ce mouvement dans l'histoire des sociétés malgaches au XIXe siècle. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Support Section Localisation Statut Disponibilité 4021 Livre Anticolonialisme Mille Bâbords Document en bon état Disponible Etre métis en Imérina (Madagascar) aux XIX° et XX° siécle / Violaine TISSEAU
Titre : Etre métis en Imérina (Madagascar) aux XIX° et XX° siécle Type de document : texte imprimé Auteurs : Violaine TISSEAU, Auteur Editeur : Paris : Karthala Année de publication : 2017 Importance : 415 pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8111-1855-6 Prix : 27 euros Langues : Français Catégories : Sciences humaines Mots-clés : racisme métissage métis madagascar Note de contenu : Si cet ouvrage est centré sur le moment colonial (1896-1960), il remonte néanmoins au XIXe siècle précolonial pour montrer comment la colonisation a construit la catégorie « métis ». Il intègre aussi des prolongements contemporains en analysant comment les métis ont su contourner ou se réapproprier cette catégo-risation en jouant de leurs appartenances multiples. Etre métis en Imérina (Madagascar) aux XIX° et XX° siécle [texte imprimé] / Violaine TISSEAU, Auteur . - Paris : Karthala, 2017 . - 415 pages.
ISBN : 978-2-8111-1855-6 : 27 euros
Langues : Français
Catégories : Sciences humaines Mots-clés : racisme métissage métis madagascar Note de contenu : Si cet ouvrage est centré sur le moment colonial (1896-1960), il remonte néanmoins au XIXe siècle précolonial pour montrer comment la colonisation a construit la catégorie « métis ». Il intègre aussi des prolongements contemporains en analysant comment les métis ont su contourner ou se réapproprier cette catégo-risation en jouant de leurs appartenances multiples. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Support Section Localisation Statut Disponibilité 4024 Livre Anticolonialisme Mille Bâbords Document en bon état Disponible